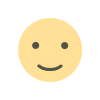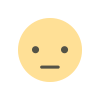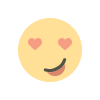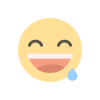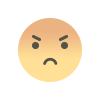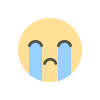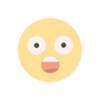Dialogue ou impasse ? L’appel d’Ingabire pour une paix durable dans les Grands Lacs

Dans la cacophonie géopolitique de la région des Grands Lacs, une voix se distingue par sa clarté et son courage : celle de Victoire Ingabire Umuhoza, opposante rwandaise emblématique. Depuis Kigali, elle exhorte le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC) à faire ce que peu de dirigeants osent envisager : dialoguer sincèrement avec leurs opposants et leurs réfugiés politiques, qu’ils soient sur leur sol ou en exil.
« Il est grand temps que le Rwanda et la RDC engagent un dialogue avec leurs réfugiés et membres de l’opposition, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs pays respectifs. Cela permettra non seulement d’assurer le succès à long terme de l’accord de paix négocié par Washington, mais aussi de rétablir la confiance entre les responsables étatiques des deux côtés, et d’ouvrir la voie à une véritable coopération régionale, qui aidera les deux nations à prospérer après avoir enfin atteint la paix », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Al Jazeera.
Ce plaidoyer ne tombe pas du ciel. Il s’inscrit dans un contexte où les efforts de paix entre Kinshasa et Kigali, impulsés par les États-Unis, peinent à produire des résultats tangibles sur le terrain. Les conflits armés à l’Est de la RDC, les accusations croisées de soutien à des groupes rebelles, et la méfiance chronique entre les deux États continuent d’alimenter un cycle de violence sans fin.
Mais Ingabire va plus loin. Elle pose une question essentielle : peut-on vraiment parler de paix sans la participation des voix exclues du débat ? Sans les réfugiés, les dissidents, les opposants en exil, souvent criminalisés ou réduits au silence ? Elle-même en sait quelque chose. Ancienne prisonnière politique, présidente du parti DALFA-Umurinzi, elle incarne cette volonté de transformation pacifique par les idées et le dialogue.
Ce qu’elle propose, c’est un tournant stratégique : sortir du schéma répressif et sécuritaire pour embrasser une diplomatie du dialogue, centrée sur l’humain. Une telle approche ne signifie pas naïveté politique. Elle impose au contraire du courage, de la lucidité, et un sens aigu de l’histoire.
Car l’histoire de la région prouve que les exclusions nourrissent les conflits. Et que seule une inclusion réelle — politique, sociale et mémorielle — pourra construire la confiance nécessaire à une paix durable.
Les dirigeants de la RDC et du Rwanda écouteront-ils cet appel ? L’avenir de millions de citoyens en dépend.
DKM